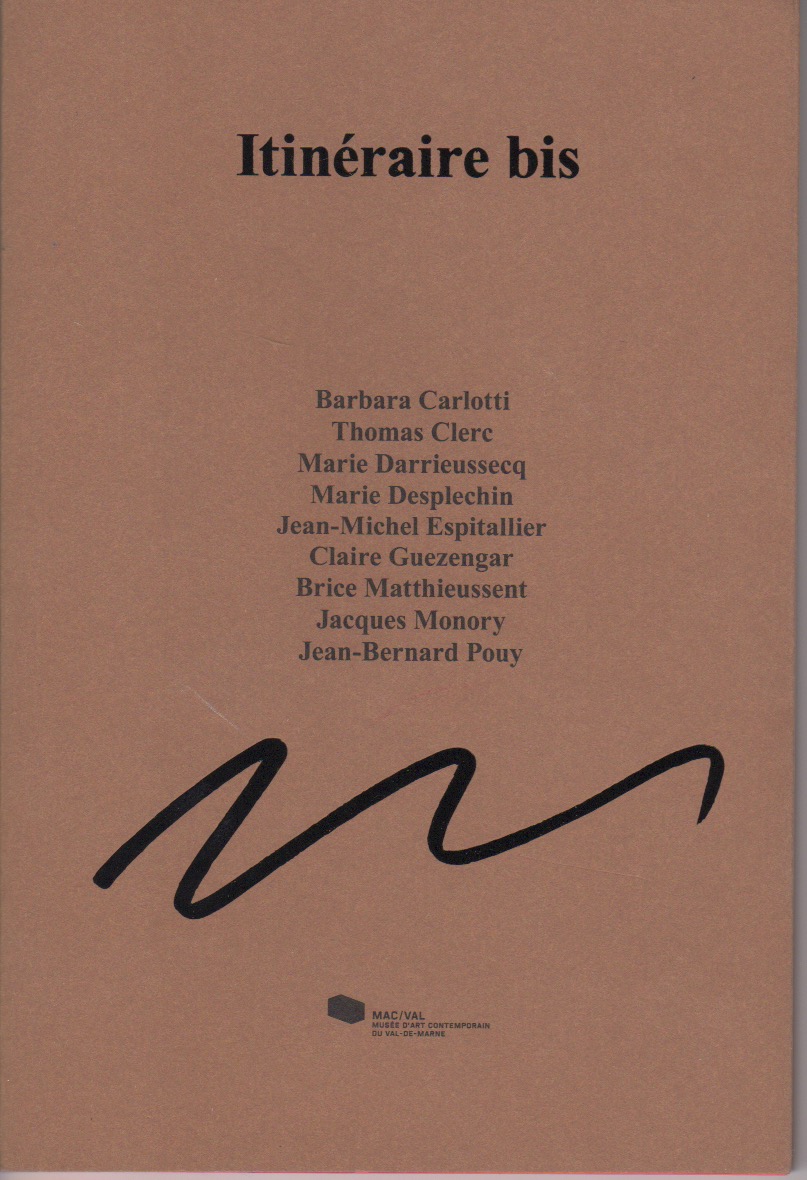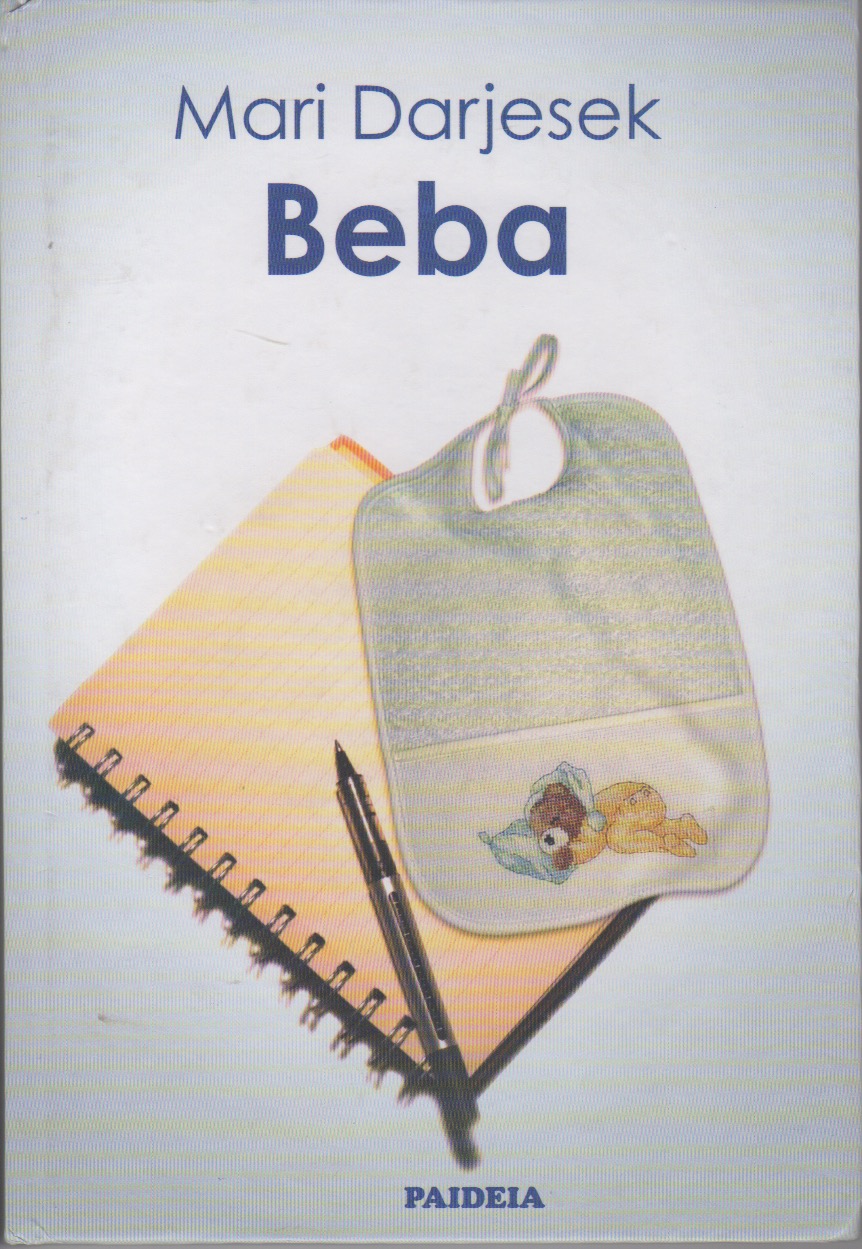Texte paru dans une première version dans un catalogue d’art au MAC/VAL, Itinéraire bis (2011) et repris dans cette autre version dans la NRF, numéro de novembre 2016

Je n’avais pas tellement envie d’aller à Belgrade. Disons que Belgrade n’était pas classée très haut sur ma liste de destinations rêvées. On a beau dire, ça fait un certain temps que les Serbes n’ont plus très bonne réputation en Europe, voire dans le monde, si tant est que le monde sache placer la Serbie sur une carte. Si vous demandez, par exemple, à un Albanais ou à une Bosniaque ce qu’il ou elle pense des Serbes, sa réponse risque d’être mitigée.
Moi, j’aime bien les Serbes, ou du moins les quelques Serbes que je connais, parce que l’équipe de Serbes qui a entièrement rénové mon appartement a fait du très bon boulot, dans les temps et pas trop cher. Au point que pour fêter ça, le sympathique Serbe en chef m’avait invitée à dîner chez lui, en banlieue parisienne, et que tout s’était bien passé jusqu’à ce que je ressente une impression également mitigée devant une photo dans un cadre doré : lui, mon entrepreneur, serrant la main de Milosevic, tous les deux entourés de drapeaux de supporters de foot serbes et de pom pom girls serbes en habit folklorique.
C’est donc avec un enthousiasme mesuré que j’attendais mon avion pour Belgrade. Je ne prends quasiment jamais de vacances mais je me débrouille pour faire un peu de tourisme pendant mes voyages professionnels. Ce qui consiste, entre deux rendez-vous, à me poser à une terrasse de café en essayant de me laisser convaincre par le concept de farniente. En général, c’est la panique qui me gagne. Je trouve qu’en effet il ne se passe rien, en vacances. Une impression de marée basse qui ne remontera jamais. Ou de foule éparse, réunie là sans motif compréhensible. A moins que ces moments vides ne disent quelque chose du tourisme fondamental de mes voyages professionnels.
L’avion a décollé en retard de Roissy CDG et a atterri avec encore plus de retard à Belgrade, après avoir contourné un monstrueux orage sur le Nord des Balkans. On distinguait au loin des formes fantastiques sur une ligne noire de nuages évités, un incendie rouge, blanc et brun, « plus brillant que des milliers de soleil » commentait en roulant les R mon voisin qui avait déjà dû abuser de la šljivovica. Dans le hall des arrivées, un jeune homme porteur d’un panneau DAROSEQ attendait visiblement que je me pointe. Il s’empara de ma valise et m’indiqua, parlant fort et articulant serbe, le 4x4 vieillissant qui devait me conduire dare dare à mon premier rendez-vous.
Il tombait une pluie délirante sur la quatre voies aéroport-Belgrade, et mon jeune chauffeur, apparemment très concerné par mon retard et sa mission, ou peut-être conduisant comme doit conduire un jeune Serbe, roulait à 160km à l’heure, ce qui personnellement me semblait excessif, il prenait les choses trop à cœur, personne ne songerait à l’accuser de mon retard, c’était la faute des orages et des compagnies aériennes. Better late than dead – essayais-je de lui expliquer en anglo-croate, ou en franco-serbe – plutôt en retard que morte, j’étais prête à en appeler à la sainte alliance de nos deux nations pour lui faire ralentir la machine. Le long de la quatre voies où selon des trajectoires audacieuses il en traçait une cinquième, pendant que d’autres bagnoles inventaient, dans des giclées aquaplaniques, des sixièmes et des septièmes voies, filaient à vive allure les carcasses immobiles de voitures carbonisées, aplaties, compressées.
Le Danube surgit d’un coup dans le pare-brise, mais nous ne traversâmes pas le pont vers Belgrade. Le jeune homme tendit le bras par là, vers les berges. Il alluma la radio, trompettes et cymbales, et le Danube fracassé de pluie montait vers nous, le pare-brise battu par les essuie-glace virait à droite, à gauche, rapidement, les détails du monde se fragmentaient et Belgrade s’éloignait à regret dans la vitre arrière. La conversation languissait, le chauffeur me pointait ça et là des objets en prononçant des mots, puis il cessa de faire le guide et nous continuâmes à rouler.
La pluie s’arrêta d’un coup, et le Danube disparut : nous entrions dans un tunnel, la radio se mit à cracher et je perdis le réseau téléphonique que je venais d’attraper. Quand nous ressortîmes un soleil perplexe perçait les nuages au hasard. Le chauffeur avait ralenti et tendait le cou en marmonnant dans son serbe obstiné. Un paysage circonspect hésitait entre des friches industrielles et des bosquets intoxiqués, avec sur l’horizon des barres en béton communiste. Au fond d’une impasse, le chauffeur fit demi-tour en criant. A travers la barrière des langues je saisissais le sens général : il était perdu et très embêté.
Je retrouvai dans mes papiers l’adresse du rendez-vous, avec l’éditeur de mon livre Le Bébé. En général les éditeurs sont en centre-ville, du moins pas très loin des villes, certes il y a des éditeurs à la campagne mais quand même. Le jeune chauffeur me dit quelque chose en articulant bien, décidément j’étais bouchée, sûrement que sans GPS ça ne lui servait à rien cette adresse. Nous avançâmes encore entre deux rangées de grillage abattu, sur la droite il y avait quelque chose comme une centrale nucléaire désaffectée, sur la gauche un terrain plus que vague. Le jeune homme s’était de nouveau arrêté, et je ne pouvais pas lui proposer Google Sat puisque je ne recevais aucun signal sur mon portable, on n’était pas avancés.
Il sortit de la voiture et, dans un réflexe bête, ferma les portières, clonk. Le 4x4 sans GPS était au moins équipé d’un système de verrouillage centralisé. Je le voyais bien, que c’était un réflexe bête, mais toute une partie de mon cerveau commençait, telle la souris prise au piège, à examiner les possibilités de fuite, de secours, d’échappée. Mon geôlier téléphonait, il avait un réseau, lui, un réseau réservé aux Serbes peut-être. Bla bla bla DAROSEQ bla bla bla DAROSEQ, c’était tout ce que j’entendais : les trois syllabes claquaient régulièrement comme la désignation d’un problème. Et j’avais beau le trouver sympathique, et comprendre (malgré la barrière des langues) que tout ça n’était qu’un malentendu, un contretemps, une étourderie de sa part, il aurait dit « je la tiens, qu’est-ce que vous foutez ? », de mon point de vue c’était kif kif. D’ailleurs, DAROSEQ, était-ce bien moi ? Il attendait peut-être un otage du nom de DAROSEQ ?
Il me fit signe de sortir, je voulais bien mais. Il eut un geste désolé et déverrouilla les portières. Il fallait que je le suive, on aurait plus vite fait à pied, il tapait de la semelle et tendait un bras urgent vers les barres de béton soviétique. Bien bien, da da. L’espèce d’usine désaffectée devant laquelle nous étions garés ressemblait à la Tate Modern, mais sans la rénovation ni Londres. Le sol était jonché de débris, une portière de voiture, une fourche de mobylette, un tube de téléviseur, un bidon marqué inflammable, un vieux maillot de bain, on imaginait tomber sur un corps, on zigzaguait entre les flaques boueuses et le verre brisé.
Il s’agissait d’emprunter un passage sous les HLM. Les rez-de-chaussée étaient barrés de planches, les premiers étages condamnés par des briques : c’était peu engageant, tout ça. Je n’avais toujours pas le réseau. Bien bien, da da, il était tellement sympathique, et à ce que je comprenais, il serait vraiment dans la govno s’il me perdait en chemin. Je le suivis, le tunnel très sombre descendait puis remontait : nous rejaillîmes dans une lumière aveuglante – c’était le Danube, oui, « plus brillant que des milliers de soleil », le confluent du Danube et de la Sava, une eau large comme une mer, jaune et rapide, surpuissante, avec des îles d’herbes filant dans le courant.
Contre toute attente, la berge, sans doute un ancien chemin de halage, était aménagée en piste cyclable. Nous la suivîmes quelque temps à pied. Des cyclistes vêtus de fluo tiraient des carrioles pour enfants, on se serait cru en Allemagne. Tout rutilait après l’averse, Belgrade au loin étincelait dans une brume de coupoles orthodoxes, on y croyait presque, à la Serbie de demain. Nous trouvâmes enfin la maison d’édition – un loft ultramoderne ouvert sur le Danube, avec bistrot et librairie. M’y attendait un éditeur installé là depuis trente ans : « un jour, me dit-il dans un français superbe, le quartier va décoller, c’est sûr ». Une dizaine de dames surgies de nulle part se présentèrent en un groupe suspect (un minibus de figurantes ?), chacune était armée d’un bébé et voulait me faire signer le livre du même nom. Une très petite fille hurlait dès qu’on lui enlevait son exemplaire, apparemment adopté comme doudou, et c’était un peu déstabilisant de dédicacer ainsi sous les hurlements de la destinataire (je signai DAROSEQ).
J’ajoute qu’à cette occasion, pour la première fois en quinze ans de tourisme éditorial, je dédicaçai un livre pour un chien, un teckel à poil ras du nom de Kay (je m’en souviens), présenté par une vieille dame comme son bébé.
Tout me semblait merveilleux, beau, libre, accueillant et sympathique. Je visitai la maison d’édition, parlai avec quelques journalistes. Puis je pris un café avec mon éditeur octogénaire et ultra-pionnier, qui avait connu tous les régimes et toutes les guerres et espérait toujours, optimiste et survivant, dans son quartier.
Le sympathique chauffeur me ramena à Belgrade, tout droit, par le Novi Beograd construit par Tito. Demeuraient, ostensibles le long des boulevards, les ruines des bombardements de l’OTAN. Le chauffeur égrenait d’un ton victimaire ce que j’entendais comme des dates, toutes en l’année Two Thousand, le journal d’une défaite. Je trouvai une terrasse de café en centre-ville et pris dix minutes de vacances bien méritées.
Le lendemain (il y a ensuite un lendemain puisque je n’avais ni été kidnappée ni découpée en morceaux, j’étais libre et en vie), le lendemain un orage terrible, peut-être celui qui avait retardé l’avion, se positionna exactement là-bas, au loin sur les berges, au confluent du Danube et de la Sava, et je pris une photo avec mon téléphone portable (qui n’assurait plus que cette fonction). Et j’avais beau me dire que les photos de vacances n’intéressent personne, et que mon aventure de la veille était typiquement touristique, je prenais la photo pour me souvenir, pour me souvenir que j’étais libre et en vie – aussi libre que possible, et complètement en vie.