Entretien avec Thomas [1] pour l’Observatoire des prisons, dont Marie Darrieussecq est une des marraines. L’entretien est paru dans le recueil Passés par la case prison, éditions La Découverte, 2014.
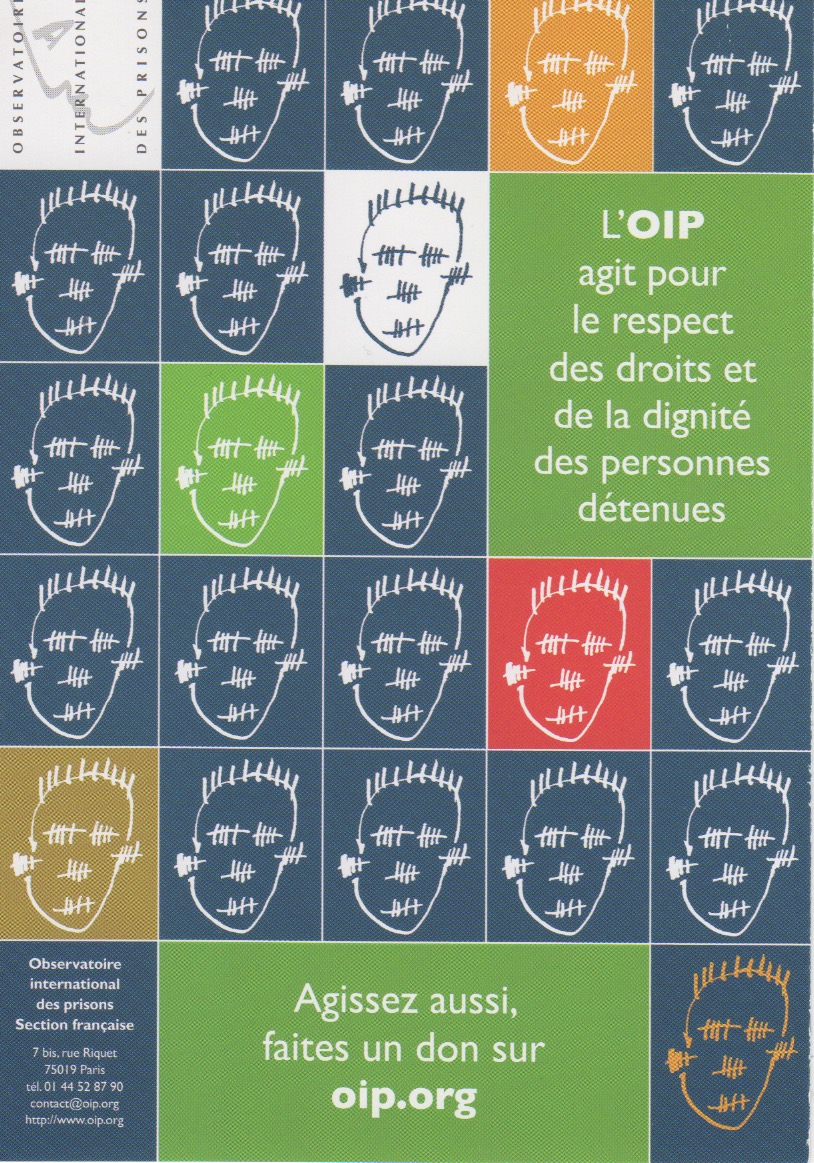
« Je suis étudiant en droit. J’ai vingt-trois ans. J’aurais voulu être avocat. Mais la loi de 1976 prévoit que « nul ne peut exercer la profession d’avocat s’il a commis des actes contraires à la probité, à l’honneur, à la loyauté et aux bonnes mœurs ». Je voudrais travailler comme juriste, en droit du travail. Avec le droit pénal, c’est le droit le plus philosophique : il régit une grande partie des relations humaines.
Mon père a fait des études de médecine. Ma mère n’a jamais pu passer le CAPEC parce qu’elle m’a eu, moi. Mes parents se sont séparés dès ma première année. Mon père a une très bonne situation. Ma mère est d’un milieu pauvre, et la seule de sa fratrie de sept à avoir fait des études.
J’ai très peu vu mon père. Il m’a payé quelques billets pour aller le voir où il vivait, à Amsterdam. J’ai appris le néerlandais sur place. Le contraste était saisissant : ma mère n’avait pas de quoi m’acheter des barres chocolatées, et lui, il m’emmenait à Eurodisney. Il ne nous a jamais aidés.
Ma mère, qui n’était pas titulaire, changeait de poste souvent, et moi je changeais d’école. Nous avions toujours des logements minuscules, nous sommes aussi passés par deux structures d’accueil. Et puis ma mère a trouvé un bon poste dans un lycée professionnel. C’était une bonne vie, de la sixième à la quatrième. On a acheté un ordinateur à la FNAC. Et puis à la fin de la quatrième, alors que j’avais ma toute première petite amie, il a fallu encore déménager ; le contrat de ma mère n’était pas renouvelé.
Nous sommes retournés sur les lieux de ma petite enfance, à Saint-Etienne, chez une tante. Ça s’est mal passé. Ma mère m’a élevé avec beaucoup d’amour et de tendresse, mais sa famille — la façon dont ils se parlent entre eux… Ma mère avait des rapports très conflictuels avec eux.
On est partis un temps chez ma grand-mère, et puis on a trouvé un appartement à La Ricamarie, une banlieue dure de Saint-Etienne. J’y ai fait mon début de troisième. Je n’étais pas habitué à cet univers. Je venais de petites villes sympa, et la différence de niveau entre moi et les autres était telle que les profs ont poussé ma mère à m’inscrire en centre ville. Mais les mercredi et les weekends, c’était la Ricamarie. Mes cousins et mes oncles y formaient un très grand réseau, et je me retrouvais avec une bande de copains de mon âge. J’avais gardé de forts liens avec ma petite amie, mais les billets de train étaient trop chers, et ma mère n’a jamais eu le permis.
J’avais deux personnalités, et des facultés mimétiques très fortes, à cause des déménagements. Et le besoin d’être intégré qu’on a tous à cet âge. Quand j’étais avec un milieu, j’avais « honte » de l’autre. Le vocabulaire, les gestes, tout était différent. D’un côté la violence dans les mots, la violence du quotidien ; l’entretien d’embauche du père qui se passe mal et le père qui transmet tout cette violence à ses enfants, qui la transmettent à leurs camarades. De l’autre ma meilleure amie dont le père était un radiologue renommé. Je ne pouvais pas réunir les deux côtés.
Il y a eu une première embrouille, autour d’une fille. Son petit ami de 18 ans m’a accusé de la draguer, j’en avais 14… Qaund je l’ai vu qui m’attendait à la sortie des cours avec dix potes à lui à scooters, je me suis décomposé… et je regarde de l’autre côté du trottoir : mon cousin avait organisé quarante personnes de mon quartier. J’ai ri de soulagement. Je me sentais redevable, je me sentais intégré. Mais ça créée de la dette. Plus insidieux : je me suis crééé de la dette par rapport à moi-même. J’ai commencé à aller donner des coups de main. J’ai vite été connu par tout le monde. J’étais déjà grand à 14 ans, certes pas bien épais. Ma mère n’était pas consciente de tout ça. J’étais habitué à lui répondre ce qu’elle voulait entendre. Je la protégeais. Je ne sortais jamais le soir. Les conneries, on les faisait la journée.
Je passe en seconde. J’aime bien l’école. Les profs ne sont pas conscients que je suis entre deux mondes. 2005. Les émeutes urbaines. La télé. Tous les soirs à la télé, ça brule en France, jusqu’à Lyon, jusqu’à Saint Etienne.
Ce dimanche là je sors comme d’habitude, je trouve un pote dans la rue, on arrive à un carrefour, on tombe sur un autre qu’on connaît. Ça s’est joué à une seconde, celui-là, de ne pas le croiser. Il avait 18 ans, il avait fait de la prison, il avait une grosse réputation.
On va faire un foot. On croise d’autres potes. On marchait beaucoup à l’époque, d’un quartier à l’autre, c’est une ville de ghettos. Il n’y avait pas de téléphone portable. On se retrouve à une trentaine, des rencontres de malchance. Il y avait des grands qui fumaient des joints, nous on ne fumait pas, on était sportifs. Nous les moyens, les « intermédiaires ». Tout le monde parlait des émeutes, « ici ça brûle pas », « il faut brûler des voitures, il faut brûler le lycée », quelqu’un dit : « il faut brûler un bus ». Un bus, ça ne s’était encore jamais fait. Les scooters tournent. On n’était pas exactement à discuter autour d’une table… Quelqu’un ramène un gros bidon d’essence. Les plus vieux font des cocktails Molotov. On regarde comment ils font.
J’étais entièrement habillé de rouge, un truc de môme, tout assorti. Et un bus arrive. Là encore, un mauvais hasard. Des bus le dimanche, il n’y en a pas souvent… C’était la ligne 1, la seule ligne qui traverse notre quartier. Ma grand mère prend ce bus. Je me fais prêter une écharpe, je relève ma capuche… On se partage les rôles, on envoie deux petits de onze ans arrêter le bus, je me charge de faire sortir les gens. Il n’a jamais été question de brûler autre chose qu’un véhicule.
J’entre dans le bus. Je suis le seul à y entrer. Je dis aux gens de sortir. Je ne me souviens pas de mon état mental, c’était le vide. Je me souviens de crier : « Sortez, le bus va brûler ! » Personne ne sort. Personne ne me croit. Et tout d’un coup c’est la panique, tout le monde se rue dehors. Un grand est en train de balancer des rasades par la porte d’entrée, je me rappelle de deux grands « splash ». Les gens sortent par les deux autres portes. Et le grand allume, ni une ni deux.
Le chauffeur je ne me souviens pas. Je me souviens de marcher dans le couloir en disant aux gens de sortir, et je sors derrière eux par la porte du milieu. Et là, impossible de savoir si j’ai vu, ou si j’ai imaginé : il reste une personne dedans, une mamie.
On court, il y a la police et les pompiers, on est très loin de chez nous. Et le soir aux infos je vois qu’une personne âgée a été brûlée.
Est-ce que j’ai reconstruit après coup ? Je la vois, là, quand je vous parle, elle est immobile. Mais moi, si je l’avais vue, je serais retourné en arrière.
J’entends aux informations que le chauffeur est re-rentré pour l’extraire du bus. Elle a été brûlée sur une partie du visage.
C’était un dimanche. Le 6 novembre 2005. Le lendemain, pas de bus, donc pas d’école. Les conducteurs exerçaient leur droit de retrait. On se retrouve tous, la même équipe, à l’arrêt de bus. On parle de la vieille dame. On dit « ça craint pour la personne ».
Le mardi, on va en cours. Je retrouve l’autre côté de mon monde . Et cette fille, ma meilleure amie, ou ma petite amie, à cet âge-là c’est ambigu. Je lui avais dit, quand les émeutes ont commencé : « Ce samedi à La Camarie ça va être comme dans les autres villes de France ». Cette phrase ne nous a pas aidés car elle a laissé présumer que l’incendie était prémédité, alors que tous nous insistions sur la spontanéité des faits.
Le mercredi au MacDo mes potes et moi nous tombons sur T., un cousin de mon cousin, qui nous dit qu’on l’a arrêté, 48 heures de garde à vue à protester qu’il n’avait rien à voir avec tout ça. Là on se rend compte que c’est chaud. Sarkozy était déjà dans une logique de l’exemple, sa logique du karsher, celle qui a mené à la mort des deux jeunes dans le transformateur. Les policiers avaient reçu l’ordre d’arrêter tous ceux à la ronde qui avaient un casier. L’idée c’est qu’il y en avait bien un qui parlerait. L’affaire était devenue « le bus de l’arrêt Camarie ».
Le mercredi soir, j’étais chez moi, je mangeais une tartine de Boursin. Je devais apprendre une poésie pour le lendemain et j’étais un peu en retard. Ça sonne à la porte. Personne ne nous rendait jamais visite le soir, à ma mère et moi. Je laisse ma tartine et je tombe nez à nez avec un policier en civil, il avait seulement la veste de police. Et deux ou trois flics derrière lui. « Vous vous appelez Jamel T. ? » « Non, Thomas K. ».
Je m’appelle Thomas Jamel. Au lycée on m’appelle Thomas. Au quartier on m’appelle Jamel. J’ai un germain qui s’appelle T., qui est très connu. Un ami m’a balancé, en croyant que je m’appelais Jamel T.
Les flics me suivent dans ma chambre. J’oublie d’allumer, on est en novembre, il fait noir, c’est la fin, j’ai peur. Je me retourne, je dis : « il faut que je retourne allumer », le premier flic panique, les autres me tombent dessus, la maison se remplit, je vois par la fenêtre qu’il y a des flics partout, sur les toits, sur les garages, aux issues, partout.
Ils vont au sale prendre mes vêtements, pour faire des relevés. On avait acheté des chaussures toutes neuves la semaine avant. Ma mère me les mets au pied, me les lace. Les flics lui disent : « c’est pas la peine, on va lui enlever ses lacets ».
Je suis embarqué dans une voiture. Plusieurs membres du GIGN braquaient leurs armes à l’intérieur du bar d’en face, tenaient en joue les clients pour que personne n’intervienne. Il y avait même un hélicoptère. Un convoi se regroupait peu à peu, avec des motos, on filait à plus de 110km/h en plein centre ville. On a même explosé un pneu sur un trottoir et dû changer de véhicule. J’étais menotté dans le dos, quelqu’un m’avait passé une ceinture de sécurité.
On arrive au 99 cours Fauriel — au « 99 », comme on appelle le central de police. Au premier étage c’est les infractions mineures, au deuxième le délictuel, et je voyais passer les étages : on montait au troisième, à la crim’. C’est la culture de rue qui enseigne ça. « Vous êtes partis pour l’homicide », nous disaient les flics. Ils nous faisaient croire que la vieille dame était mourante.
Fouille intégrale à nu, se pencher, tousser. Menottes au radiateur. J’ai nié autant que j’ai pu. J’ai signé dix dépositions en disant non. Mais à deux heures du matin, je riais nerveusement. J’avais très sommeil. On est encore petit à 14 ans. Un flic a déboulé en disant « il y en a un qui a craqué ». On m’a demandé de confirmer. Le flic a dit « coupe la caméra. » Une baffe, deux baffes, comme jamais dans ma vie. Ma tête a cogné contre le mur. Je me suis mis à trembler. J’ai avoué. Tout ce qui s’était passé.
Ces méthodes ne sont plus possibles aujourd’hui. Grâce à la réforme de la garde à vue en 2011, on a un avocat dès la première heure. Il faut dire qu’avant 1999, on faisait courir les gens nus dans les couloirs en leur faisant des croche-pattes.
On s’est retrouvés en cellule de garde à vue, cinq ou six de mon groupe. C’était une espèce de couloir avec un banc en pierre au fond. On était contents de se voir. On s’est allongés par terre, on a parlé, on a essayé de dédramatiser. Et on a fini par s’endormir. Il faisait chaud parce qu’on était serrés.
Le lendemain, on nous a emmenés dans la souricière du Palais de justice. On se parlait à travers les barreaux. On avait très faim. On a eu un sandwich au fromage. On était tous menottés, avec une petite laisse bleue. Le juge a convoqué ma mère. Au mot de détention, je me suis mis à pleurer. Ma mère m’a serré dans ses bras. Ça me déchirait de la voir comme ça. On m’a emmené par la laisse. Le contraste entre ce câlin tout juste ébauché, et la laisse…
Le trajet en voiture, de nuit, a duré deux heures et demie. J’avais mal aux épaules à cause des menottes dans le dos, et j’avais très faim, mais je me suis endormi. A cet âge-là, on dort. Les seules places qu’il y avait étaient dans un centre de détention Plan 13000, à Varennes-Le-Grand. On s’est s’engagé sur une longue route vide, dans un no man’s land à l’américaine, avec des projecteurs. Je voyais le bâtiment grandir, grandir, et devant la porte je me suis dit : « c’est fou, de ma vie je n’ai jamais pensé que j’irais en prison ».
La fouille à nu. Et la douche. Ça, c’était agréable. L’eau chaude sur le corps. Manger, le paquetage, des biscuits. Et la détente. On n’a plus rien à cacher. Je ne sais pas si ça commence avec la prison ou avec l’aveu. Ce que je sais, c’est que tant que l’espoir est là, on n’est pas bien. L’arrivée en prison, c’est le moment où la peur cesse. Tout le monde le dit. Peur de ne pas avoir pas de boulot, de diplôme, peur de l’échec, peur de demain, peur de ne pas payer son loyer, peur de se faire renverser par une voiture, de se faire voler son sac, de perdre ses clefs… « Est-ce que j’ai bien fermé derrière moi ? » C’est fini, les questions. On a l’esprit vide. Et la première nuit dans un lit. Après ces gardes à vue qui peuvent durer des jours, la lumière jamais éteinte, le banc en pierre, pas de douche, les odeurs immondes etc… On a ce sentiment, ouf, d’être arrivé.
Mon pote et moi, on était dans la même cellule, les gars ont été sympas. On est tombés tous les deux. D’un sommeil de plomb. Non, c’est faux : en prison on est réveillé tout le temps. Le surveillant passe toutes les deux heures, j’ai encore dans l’oreille le toutoutout du talkie-walkie et le bruit des clefs. On espère qu’il va ouvrir. Il n’ouvre pas. Et puis à 6h30, oui, il ouvre et il appelle : mon nom et celui de l’autre. Pour voir si on est toujours vivants.
Le réveil, c’est à 7h30, un chariot avec du chocolat au lait. On s’entendait bien, avec mon co-détenu. On ne sortait pas en promenade, on ne voulait pas d’histoires. Je suis resté là un mois et demi. J’avais fait, dès mon arrivée, une demande de rapprochement familial. Pour venir me voir ma mère mettait 2h30 de train, plus le taxi. On m’a transféré à la Talaudière, à Saint Etienne. Et là, j’ai fait la différence.
Varennes-le-Grand date de 1990. La Talaudière est une très vieille prison. Il manquait des carreaux au sol de ma cellule, sur le sol en terre. Les sanitaires étaient dégueulasses. Les barbelés étaient pleins de trucs qui pendaient. Les fenêtres étaient très sales, lumière électrique toute la journée. On mange dans sa cellule. On ne sort qu’une heure par jour, c’est l’obligation légale. Je n’allais pas à l’école car mon niveau était trop haut. J’étais seul dans ma cellule, c’est la loi quand on a moins de seize ans. La claustrophobie, je n’y pensais pas. J’étais dans la télé. Je faisais quelques pompes, et sinon, la télé. Du matin au soir. La lecture c’est actif. Ça n’anesthésie pas. C’est trop constructif, ça fait appel à notre créativité. La télé, elle, prend en charge. Comme la prison.
J’avais un cousin chez les majeurs, il était très connu et personne ne m’a embêté. Tout le monde me filait des trucs à manger. Le cousin me passait des bouts de shit, que j’échangeais contre des canettes d’Orangina, des Chocapics, des Snickers. Le matin je me gavais de sucreries devant les dessins animés, le surveillant me disait d’arrêter… On m’a même prêté une console de jeu alors que c’est interdit. Ma mère venait au parloir deux fois par semaine, elle me passait des sandwiches en douce avec de la viande dedans. Comme j’étais mineur, je ne pouvais pas cantiner. En prison, la base c’est la viande en sauce, c’est immangeable. Quelle viande ça peut être ? La lampe à l’huile, je l’ai fait. On se fait cuire des trucs dedans... C’est cancérigène, mais sinon on meurt de faim.
Je suis resté en prison parce que je n’avais pas d’endroit où aller. J’étais interdit de territoire et ma mère n’avait pas les moyens de déménager. Quatre mois, puis cinq. On m’a enfin trouvé un centre de placement immédiat, à Roanne. Une éducatrice est venue me chercher. Je me suis assis dans la voiture, normalement. Et je suis resté un an et demi dans ce centre, où on ne peut rester que six mois maximum.
Je suis tombé dans un trou. Un trou entre le juge d’instruction et le juge pour enfants. L’un aurait dû prendre le relai de l’autre, mais entre les deux on m’a oublié. Il ne se passait rien. Je demandais une permission pour aller voir ma mère ? Personne ne répondait. Et personne ne pouvait me sanctionner non plus. Je n’avais ni week end, ni vacances. Mon avocate ne faisait rien. Ma mère était dévastée par la situation et sa propre impuissance. Je faisais des conneries. Je devenais insupportable. J’étais exaspéré.
Sur douze places, j’étais le seul scolarisé. Je redoublais ma classe de seconde parce que j’avais manqué six mois de cours, avec mon incarcération. Le lycée était à vingt minutes de marche et les éducateurs calculaient mon temps. Je ne pouvais aller à aucune soirée, je n’étais autorisé à sortir que le mercredi après midi. J’avais parfois des permissions de 21h : je partais quand la fête commençait. Le milieu est trop restrictif pour des placements aussi longs, et ne tolère pas la crise d’adolescence. J’étais ironique, provocateur, manipulateur. On a écrit soixante rapports sur moi, que personne n’a lus : « ne veut pas faire la vaisselle »... Et tout le monde me disait que j’allais prendre 20 ans, pour l’exemple. Je me suis mis à fumer, beaucoup, tabac et shit.
J’ai fait du trafic. J’avais eu une bonne formation, auprès des grands, pour ramener de l’argent. Je volais des voitures. Je roulais de façon suicidaire. On m’a pris, une fois, sur une tentative de vol. Et j’ai enfin eu ma juge. Elle m’a recadré. Je suis passé en première avec les félicitations.
J’avais seize ans, ça faisait treize mois que j’étais là. Un soir on a fait un feu de joie, sur la grosse dalle en béton au milieu du jardin. Il y avait un nouveau veilleur de nuit, qui nous laissait faire et même participait. On s’amusait à enflammer du déodorant, et les voisins ont appelé la police. « On est chez nous, on fait rien ! » Au matin j’étais heureux parce que je venais d’emballer ma copine pour la première fois. Je mangeais des croque-monsieurs. Il était sept heures. Et les flics sont revenus nous arrêter.
Pendant la garde à vue, le veilleur de nuit nous a enfoncés. J’ai été incarcéré pour « destruction de biens publics ». Je n’ai jamais compris.
Quelque temps auparavant ma mère était venue me voir en me disant : « je vais me suicider, et ton père sera obligé de s’occuper de toi ». J’étais sidéré. Et elle a fait une tentative de suicide aux Pays-Bas. Elle s’est ouvert les veines, a été sauvée par une femme de chambre, et s’est retrouvée en hôpital psychiatrique. Elle avait laissé une lettre à mon père, et c’est lui qui m’a averti, d’une façon dégueulasse, sans aucune compassion. Je ne savais plus si elle était morte ou vivante, tout était complètement fou, tout était possible. Ce jour-là j’ai pris une cuite. Je n’avais jamais bu d’alcool de ma vie, ma mère est musulmane. Quand j’ai pu la voir, à l’hôpital, trente minutes, elle m’a dit : « J’ai raté ma TS, maintenant je veux vivre ».
Mais en prison, j’ai perdu sa trace, et elle a perdu la mienne. C’était une double peine. Je n’avais plus de visite, pas d’argent, pas de tabac. J’avais faim, je mangeais des pâtes crues. Et je me suis fait casser la gueule. Par des majeurs. Trauma facial. J’ai perdu des dents. A l’hôpital pénitenciaire, j’étais menotté au lit, sans télé. J’ai perdu le fil du temps. Ensuite j’ai appris que ça avait duré trois jours. Quand je suis enfin passé devant la juge pour enfants, elle m’a dit : « « vous l’avez cherché, vous êtes toujours dans les embrouilles ». Je n’arrivais pas à parler, ma lèvre était suturée.
Jai été sanctionné pour « bagarre ». Sept jours de mitard, avec ma gueule cassée. Ma promenade était à sept heures du matin, isolé. Je comptais les jours. Je ne sais pas ce qui m’a fait tenir. Je pensais à me suicider. Ne surtout pas rêver. Le pire cauchemar en prison c’est d’être dehors : tu rêves de n’importe quoi, mais dehors. Et tu te réveilles, et tu es en prison.
Ces trois mois ont été les pires de ma vie. A ma sortie, je me souviens du vent, de la première cigarette sur le trajet… On avait fini par me trouver une famille d’accueil, dans la Loire, à la campagne.
Un jour mon référent m’a demandé de lui traduire un message qu’il avait reçu en néerlandais. C’était un médecin qui disait que ma mère avait disparu, qu’il ne savait pas où elle était. Alors j’ai dit à mon référent que ma mère était morte. J’ai dû penser qu’on me ficherait la paix avec ça. Et j’ai finalement été jugé pour l’histoire du bus : 4 ans et demi, dont 4 avec sursis et mise à l’épreuve. Les six mois fermes couvraient la détention provisoire déjà effectuée. Donc, je ne retournais pas en prison.
Dans la Loire, je me levais à cinq heures pour être en cours à huit heures, en bus. Mais ça se passait bien. J’ai réussi à passer en terminale. Je m’entendais bien avec le père. Avec les filles aussi. Je les aidais pour leurs devoirs. Et la mère ne cuisinait que des produits frais. Mais, la mère, j’étais son revenu : 1500 euros par mois. Je trafiquais un peu de cannabis pour ma consommation et avoir un peu d’argent, et elle s’est aussi mise à ponctionner des sommes sur mes ventes. Elle trompait son mari avec un gendarme, à la maison, quand le père était en déplacement. Les filles et moi, nous ne devions rien dire. Un jour le père m’a demandé si sa femme le trompait et j’ai lâché le morceau. Et j’ai tout raconté aux services sociaux.
J‘ai été retiré en urgence de cette famille. J’avais 17 ans et demi. Faute de place en foyer, on m’a logé dans un hôtel miteux jusqu’à ma majorité. Je mangeais des kebabs le soir, je passais mes week-ends seul dans une petite ville déserte... Et pendant ce temps, mon dossier avait officialisé la mort de ma mère. La fausse mort de ma mère. Je me suis concentré sur mes études. J’ai eu mon Bac, mais il me manquait de quoi vivre. La « protection jeune majeur » me donnait droit à 200 euros par mois jusqu’à mes 21 ans. Je n’avais pas d’autre ressource. Le juge qui me suivait m’a autorisé à passer l’été avec mon père, en Allemagne. Mon père ne voulait m’aider que si je restais avec lui. On s’est disputé. Il n’a même pas voulu me payer le billet retour. Nous avons cessé de nous parler. Son ex-femme, à Amsterdam, a accepté de m’héberger. Je suis resté un an. J’ai travaillé et étudié. Le problème, c’est que je n’avais l’autorisation de sortie du territoire que pour l’été.
A la fin de l’été 2010, je me suis inscrit en fac de droit à Lyon. Je m’en sortais grâce une petite bourse, à du travail, et à un copain qui m’hébergeait. J’avais une copine, avec laquelle je suis toujours. J’étais aussi conseiller municipal par intérim. Au début de l’été 2011, un voisin m’a averti que des policiers me cherchaient. J’appelle le commissariat, mais ils m’assurent que je ne suis pas recherché. Ils me le redisent quand je me rends sur place. Quelques semaines après, un autre voisin me parle d’une nouvelle descente de police : « Ils avaient l’air énervés, arme au poing et menottes à la main, il y en avait dans tout le couloir ». Je retourne au commissariat faire une main-courante pour signifier que je suis disponible. La policière a l’idée d’appeler la délégation judiciaire, et là elle change de tête : elle m’apprend qu’on en est au stade de la révocation. J’avais quatre ans de prison à faire. Et dix jours pour faire appel, grâce à un autre policier qui plaide ma cause auprès du juge d’application des peines !
Je suis passé en appel en décembre 2011, après une grosse mobilisation pour récupérer des lettres de moralité de mes profs, toutes mes fiches de paie, etc. Et 3000 euros pour payer l’avocat. Le jour du verdict, mon avocat m’explique que j’ai pris une révocation partielle de deux ans, mais que c’est une peine aménageable. Il m’assure que je vais recevoir une convocation du juge de l’application des peines. Deux mois passent sans rien. Mon avocat me jure que c’est normal. En mars, je reçois une convocation de la délégation judiciaire pour « notification de jugement ». Mon avocat m’assure encore que tout va bien se passer. Mais en réalité, une révocation n’est pas aménageable. Mon avocat s’est trompé sur toute la ligne. Et je me suis retrouvé en prison au milieu de ma première année de droit. Emmené en fourgon. Voilà pourquoi j’aurais aimé devenir avocat ; pour que d’autres soient mieux conseillés que moi.
La justice telle que je l’ai connue ne laisse pas la place pour se sentir coupable ou responsable. Elle ne laisse la place qu’à la rage. Ce n’est pas la loi du Talion, parce que le Talion est égal : il rend coup pour coup. Comment avoir des remords, quand la violence du système paraît pire que les actes commis ?
Ma copine et mes amis se sont organisés pour que je puisse passer mes examens en prison. Sans avoir pu réviser, j’ai obtenu 10,6 et je suis passé en deuxième année. Et ma peine a été aménagée. J’ai été libéré au bout de sept mois et demi, en octobre 2012. J’ai fini ma peine sous bracelet électronique jusqu’en mars 2013, puis en libération conditionnelle jusqu’en janvier 2014.
Aujourd’hui je suis fatigué, car j’ai beaucoup lutté pour ne pas craquer. Mais récemment, ma mère m’a retrouvé. A force de taper mon nom sur Google, il est apparu quand je me suis présenté aux élections de la fac. On était tellement heureux : c’était énorme ! Maintenant on s’appelle cinq ou six fois par jour ! »
[1] A sa demande, le prénom a été changé.